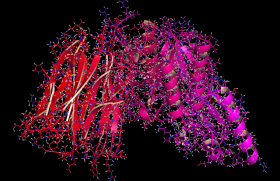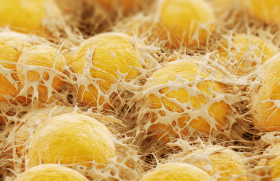Thérapeutique
Publié le 14 nov 2012Lecture 14 min
Alerte sur un médicament : entre doute raisonnable et suffisante présomption ?
L. MONNIER, C. COLETTE, Institut Universitaire de Recherche Clinique Montpellier

Au cours des dernières années, les alertes concernant les médicaments se sont multipliées. C’est le cas pour des médicaments déjà commercialisés ou en voie de commercialisation dans le domaine de l’obésité et du diabète sucré. À ce jour ont été retirés tous les traitements pharmacologiques de l’obésité agissant par la voie des neurotransmetteurs, qui régulent le comportement alimentaire. Les médicaments antidiabétiques ont également payé un lourd tribut à la découverte d’effets secondaires lors des essais de précommercialisation ou après mise sur le marché. Certains antidiabétiques dont le mécanisme d’action paraissait porteur de grands espoirs n’ont pas résisté à quelques mois ou années de mise à l’épreuve.
L’exemple des thiazolidinediones sur lequel nous allons revenir de manière plus exhaustive est peut-être le plus typique. D’autres méritent également d’être signalés : retrait des insulines inhalées aux États-Unis après quelques mois de commercialisation, « alertes » sur certaines variétés d’insuline et sur certains analogues du GLP-1. Que faut-il penser de tout ceci ? Les autorités de santé se sont-elles trop précipitées pour retirer définitivement ces médicaments ou ces classes thérapeutiques à partir de quelques « alertes » qui méritent d’être prises en compte sans pour autant conduire à une condamnation sans appel ? Ces mêmes autorités de santé ont-elles été trop indulgentes en laissant sur le marché des médicaments qui auraient dû être retirés beaucoup plus tôt ?
Ce débat est tombé dans le domaine « grand public » suite à la médiatisation du retrait d’un médicament qui fait aujourd’hui la Une des journaux de la grande presse. Avant toute chose, il convient de dire que le rôle des autorités de santé n’est jamais facile car, dans le domaine des médicaments les raisonnements binaires du type « le vrai ou le faux », le « bon » et le « mauvais » sont rarement applicables. En d’autres termes, la logique formelle des mathématiciens qui considèrent qu’une proposition qui n’est pas vraie est obligatoirement fausse, fait rarement bon ménage avec la démarche décisionnelle en matière de médicaments.
Dans ces conditions, il convient de souligner à nouveau les difficultés des agences qui sont amenées à statuer sur l’opportunité ou non de promouvoir, de freiner voire même d’arrêter telle ou telle classe de médicaments. Cette tâche est d’autant plus ardue que d’autres interférences de type politico-médiatique peuvent se mêler aux arguments purement scientifiques. La « rumeur » médiatique, pas toujours fausse, mais souvent amplifiée par des médias à la recherche du spectaculaire, ne contribue pas à la sérénité des décisions prises par des experts. De plus, il convient de souligner que ces derniers ne disposent pas toujours de l’ensemble des éléments de réponse.
À titre d’exemple, les essais thérapeutiques qui précèdent la commercialisation d’un médicament ont nécessairement une durée limitée. Si les effets secondaires comme la prévalence accrue de certains cancers sont tardifs, ils ne seront repérés que plusieurs années après la mise sur le marché du médicament. À ce moment-là ce sont les unités de pharmacovigilance, aidées par les praticiens de terrain qui jouent un rôle clé pour alerter les agences compétentes. Le travail de ces dernières est donc complexe. Quelques exemples récents vont permettre d’illustrer ce débat que nous avons volontairement affecté d’une terminologie juridique : « Alerte sur un médicament : entre doute raisonnable et suffisante présomption ».
Histoire naturelle des médicaments
Un médicament peut être considéré comme un être vivant. De sa naissance à sa disparition qui n’est pas toujours obligatoire, tout médicament passe par des hauts et des bas, même lorsqu’il arrive à son âge adulte. Tout thérapeute peut ou a pu constater que l’arrivée d’un nouveau médicament s’accompagne toujours d’une poussée d’enthousiasme avec une flambée de prescriptions qui retombe souvent au bout de quelques mois ou de quelques années, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous ou quand les premiers effets secondaires apparaissent.
Parfois, la classe thérapeutique disparaît carrément comme ce fut le cas (en octobre 2008) pour les antagonistes des endocannabinoïdes. Ces régulateurs du comportement alimentaire avaient été proposés dans le traitement des surcharges pondérales. Malheureusement, leurs effets indésirables furent tels qu’ils conduisirent l’Agence européenne du médicament à retirer cette classe de médicament qui, de toute façon, n’avait jamais reçu l’autorisation de mise sur le marché par la Food and Drug Administration (FDA).
En général et fort heureusement, les médicaments ne sont pas retirés, mais ils passent par différentes phases que nous avons résumées sur la figure 1. Après la période d’enthousiasme on observe une phase de stabilisation, suivie parfois par une période de semi-extinction, elle-même suivie par une phase de stabilisation secondaire que l’on peut décrire comme étant l’âge « adulte » du médicament.
À cet égard,la metformine est un exemple type. Commercialisée depuis 1957 en Europe, la metformine fut ensuite l’objet d’une période de défiance, voire même de rejet en raison des accidents d’acidose lactique liés à l’utilisation d’un autre biguanide, la phenformine, commercialisée surtout sur le continent américain. Ce produit fut retiré dans les années 1980, mais entre-temps, la metformine avait subi le contrecoup des déboires de la phenformine. La metformine fut réhabilitée en 1995 par les travaux de De Fronzo1. Elle est aujourd’hui l’antidiabétique oral le plus utilisé, préconisé en première intention dans le traitement du diabète de type 22. Ceci démontre clairement qu’une molécule décriée, et en danger de disparition, peut revenir au premier plan si les ambiguïtés liées à son utilisation sont levées et si le rapport bénéfices/inconvénients apparaît très avantageux après plusieurs décennies de prescription.
Figure 1. Différentes phases traversées par les médicaments au cours de leur existence.
Heurs et malheurs des thiazolidinediones
Après une longue période où les innovations thérapeutiques furent rares dans le diabète de type 2, l’apparition à la fin des années 1990 d’une nouvelle classe de médicaments, les thiazolidinediones, fit naître de grands espoirs. Ces derniers furent malheureusement de courte durée pour le premier produit de cette classe : la troglitazone3. Après des débuts prometteurs, elle fut rapidement retirée du marché en raison de ses conséquences hépatiques. Le relais fut pris par d’autres thiazolidinediones : la rosiglitazone et la pioglitazone.
La première fut prise dans la tourmente de la métaanalyse publiée par Nissen en 20074. En analysant les résultats de 42 études dans lesquelles la rosiglitazone était comparée à une autre thérapeutique antidiabétique (hypoglycémiant oral ou insuline), Nissen rapporta que le risque d’infarctus du myocarde était augmenté avec la rosiglitazone (p = 0,03) par rapport aux autres comparateurs considérés de manière globale.
Nous ne reviendrons pas sur les débats qui ont agité le landernau de la diabétologie après la publication de cette métaanalyse. Nous nous contenterons de dire que l’acceptation de cette métaanalyse pour publication est hautement critiquable dans la mesure où Nissen a inclus dans son travail des études portant sur des comparateurs très variables, avec des nombres de sujets allant de plus de 5 000 à moins de 200 et avec des objectifs pour le moins disparates. En termes clairs, le reproche fondamental que l’on peut faire à cette métaanalyse est d’avoir purement et simplement bafoué le principe fondamental des métaanalyses, qui est basé sur l’homogénéité relative des études retenues. En effet, les nombres de sujets inclus, les comparateurs utilisés, les méthodologies employées doivent être « comparables ».
Publiée dans le New England Journal of Medicine4 considéré comme la bible des études cliniques, cette étude dont les résultats furent relayés par la presse « grand public » entraîna de graves suspicions, dont la rosiglitazone ne se releva jamais. D’autres résultats plus rassurants fournis par une autre métaanalyse5 et une étude d’intervention (l’étude RECORD) pratiquée avec une méthodologie irréprochable ne permirent pas de réhabiliter la rosiglitazone6.
Aujourd’hui, ce médicament a pratiquement disparu du marché mondial. Il est prescrit de manière limitée et confidentielle aux États-Unis alors qu’il aurait peut-être suffi d’en préciser à nouveau les contre-indications bien connues de tous les diabétologues avant la métaanalyse de Nissen : ne pas prescrire la rosiglitazone et de manière générale toutes les glitazones chez les sujets ayant une insuffisance cardiaque ou une affection entraînant des rétentions hydrosodées.
Pour clore le problème de la rosiglitazone il convient de noter que la métaanalyse de Nissen, « bien relayée » par les médias et soutenue par le « principe de précaution » des agences du médicament (FDA et autres), a converti en « culpabilité » ce qui n’était qu’une alerte méritant un rappel strict des contre-indications du produit.
La pioglitazone a, pour l’instant, résisté aux attaques dont elle a fait l’objet, au moins sur le plan nord-américain et européen, en dehors de l’exception française.
En juin 2011, les médecins français apprennent par les grands médias (journaux et télévision) que l’Agence française du médicament a retiré ce produit de la pharmacopée suite à une alerte venue d’une enquête de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) signalant la présence d’un risque accru de cancer de la vessie chez les diabétiques soumis à ce type de traitement. Sans autre forme de procès, si ce n’est l’avis de quelques « experts » français réunis en conclave, un médicament prescrit depuis plusieurs années se trouva mis au pilori. Pour couronner le tout, ces mêmes « experts » furent désavoués quelques semaines plus tard par ceux de l’Agence européenne du médicament (EMA). Après avoir formulé quelques restrictions de prescription pour les sujets à risque de cancers vésicaux, l’Agence européenne se prononça pour un maintien de la commercialisation du produit à l’échelle européenne.
Cette attitude s’avéra en accord avec celle de la FDA qui maintint l’autorisation de mise sur le marché de la pioglitazone sur le continent Nord-américain.
Qui a raison ?
Comme tout le monde, les experts ne sont pas infaillibles, mais peut-être aurait-il été plus judicieux au niveau français de « donner du temps au temps », selon la célèbre formule inventée par un de nos présidents de la République. En effet, les quelques études publiées sur les relations entre pioglitazone et cancer de la vessie sont loin d’être concluantes.
L’étude la plus connue est celle de la Caroline du Nord qui a porté sur 193 000 diabétiques7. Les résultats ont montré que l’incidence des cancers de la vessie était de 68,8 cas ramenés à 100 000 patients-années chez ceux qui n’utilisaient pas la pioglitazone versus 81,5 cas pour ceux qui recevaient ce médicament. La différence de 12 cas n’était pas significative. En revanche, l’incidence augmente légèrement (p = 0,05) en fonction de la dose de pioglitazone accumulée avec le temps.
Que conclure de cette étude ?
La présence d’une alerte sur la pioglitazone mérite de faire l’objet d’une pharmacovigilance spécifique. Par contre, il aurait été peut-être plus opportun de s’aligner davantage sur les recommandations de la FDA et de l’EMA qui ont ajusté leurs recommandations en évitant la condamnation immédiate, surtout quand on sait que la consommation de tabac est autrement plus risquée que celle de la pioglitazone pour l’apparition des cancers de la vessie. Enfin, comment ne pas être surpris par l’attitude des autorités de santé françaises qui, au moment du retrait, recommandèrent de remplacer la pioglitazone par un autre médicament antidiabétique sans donner de précision supplémentaire.
Retirer la pioglitazone revient en fait à se priver du deuxième insulinosensibilisateur qui était sur le marché et qui pouvait être un recours quand la metformine est insuffisante ou mal tolérée. Par ailleurs, dire que l’on peut remplacer la pioglitazone (insulinosensibilisateur) par un insulinosécrétagogue qu’il soit gluco- ou non glucodépendant, revient à ignorer en premier lieu le rôle de la physiopathologie dans la stratégie thérapeutique du diabète de type 2, et en deuxième lieu à considérer que l’on peut indifféremment substituer tel médicament par un autre. Ce type de raisonnement paraît bien peu scientifique à une époque où l’on demande de plus en plus à tout médicament de faire la preuve non seulement de son efficacité mais aussi de son mode d’action.
Les analogues de l’insuline : une polémique fondée sur une enquête pour le moins contestable
Tout le monde sait que l’insuline est une hormone plurielle et singulière. Capable de réguler l’expression de plus de 600 gènes, elle exerce au moins deux grands types d’effets :
• les premiers sont métaboliques. Ils sont en général bénéfiques comme l’action hypoglycémiante, mais certains sont plutôt délétères comme les effets antilipolytiques et lipogéniques ;
• le deuxième type d’effet est lié au fait que l’insuline est un facteur de croissance : cet effet mitogène, mais non mutagène, explique pourquoi l’insuline qu’elle soit endogène ou exogène peut favoriser la croissance d’une tumeur jusque-là quiescente.
L’effet mitogène des insulines lorsqu’il est testé in vitro sur des cultures de cellules néoplasiques varie d’une insuline à l’autre, mais de manière globale on peut dire que l’effet mitogène est négligeable lorsque les concentrations d’insuline plasmatiques restent dans des zones raisonnables. Ainsi la première précaution est d’éviter l’utilisation de doses d’insuline trop élevées.
Tout ceci est parfaitement connu, mais la polémique est partie d’une équipe allemande qui publia dans Diabetologia en 2009 une enquête épidémiologique indiquant que la glargine augmentait le risque néoplasique, en particulier pour des doses dépassant 30 unités par jour8. Malgré la publication dans ce même numéro de Diabetologia de trois autres enquêtes épidémiologiques9 montrant que la glargine n’augmente pas le risque cancérigène, les médias s’emparèrent de la publication allemande et mirent ses résultats en exergue tout en minimisant les résultats des trois autres études. Trois ans plus tard après de multiples études portant sur des suivis de cohortes, il apparaît que la glargine n’est pas plus cancérigène que les autres insulines10.
La présomption d’innocence de la glargine est devenue une certitude avec la publication au dernier congrès de l’American Diabetes Association, à Philadelphie, des résultats de l’étude ORIGIN11. Cette étude interventionnelle a montré après un suivi moyen de 6,2 ans que les patients inclus dans le bras glargine ne développent pas davantage de cancers que ceux du groupe traitement standard. Ainsi, il a fallu plus de 3 ans et une étude d’intervention portant sur plus de 12 000 patients pour que les médecins prescripteurs et les patients traités ne se posent plus de questions sur l’innocuité de l’insuline glargine. Sa sécurité d’emploi avait été mise en doute par une étude épidémiologique mal conduite, réalisée sur des registres, et ses résultats provocateurs avaient été amplifiés par les médias peu soucieux de la qualité et de la pertinence des résultats obtenus. De manière assez surprenante, les auteurs de l’étude allemande observent un silence assez « mystérieux » depuis que les études successives ont démenti les résultats qu’ils avaient publiés en 2009.
Alertes médicamenteuses : peut-on mieux concilier « science », « conscience » et « prudence » ?
L’alerte médicamenteuse est inhérente au médicament lui-même, car tout produit chimique administré à l’homme est susceptible, au moins chez certains d’entre eux, d’exercer des effets secondaires. Quand l’alerte est déclenchée après commercialisation d’un médicament, plusieurs attitudes peuvent être envisagées en fonction du caractère plus ou moins grave de l’alerte médicamenteuse (figure 2).
Si l’alerte est sérieuse et si la présomption de culpabilité est forte, les résultats de l’alerte doivent être rapidement confrontés aux études existantes. Si l’ensemble des données convergent, le principe de précaution doit être appliqué avec suspension ou retrait définitif du médicament. Cette procédure a été utilisée pour la troglitazone, pour les antagonistes des endocannabinoïdes et pour les insulines inhalées. Elle aurait pu et dû être utilisée pour d’autres médicaments qui sont restés trop longtemps sur le marché alors que les preuves s’accumulaient contre leur maintien.
Si l’alerte est mineure ou modérée, il est conseillé de ne pas se précipiter surtout si l’alerte est portée par une étude épidémiologique réalisée rétrospectivement sur des registres. Dans ces conditions, les preuves des effets secondaires délétères du produit doivent être recherchées par des métaanalyses antérieures, par des suivis de cohortes ou mieux par des études prospectives randomisées. Les métaanalyses peuvent être très utiles à condition qu’elles soient réalisées en respectant le principe d’homogénéité que nous avons évoqué plus haut. Les suivis de cohortes, dont la durée dépend de la nature de l’effet secondaire recherché, sont indispensables. C’est ce type d’étude qui a été appliqué pour innocenter la glargine. Les études prospectives randomisées ont l’avantage de la fiabilité, mais elles prennent beaucoup de temps, ce qui peut être un inconvénient lorsqu’on souhaite une réponse dans des délais raisonnables. À notre avis, elles ne peuvent s’appliquer que lorsque l’alerte est mineure. Cette démarche serait par exemple utile pour confirmer ou infirmer le risque de cancer vésical qui a été soulevé avec la pioglitazone.
Figure 2. Alerte épidémiologique sur un médicament. Les différentes attitudes possibles selon que l’alerte est sérieuse ou mineure à modérée. L’attitude la plus contestable est l’alerte qui passe directement par les médias (partie gauche de la figure).
Dans tous les cas de figure, il faudrait que les médias « grand public » ne s’emparent pas d’une alerte pour la transformer en rumeur et pour condamner un médicament ou une classe médicamenteuse avant même que les scientifiques ou les experts se soient prononcés.
C’est malheureusement ce type de démarche médiatique qui a condamné la rosiglitazone, qui a jeté le doute sur la pioglitazone et qui a créé quelques soucis à la glargine.
Si on se place sur le versant scientifique, il est possible à l’instar de Charles Darwin de dire que « le fait de tuer une erreur rend un service aussi grand, si ce n’est meilleur que d’établir une nouvelle vérité ». Cette phrase s’applique parfaitement à la rumeur qui avait suivi la publication de 2009 dans Diabetologia au sujet de la glargine. Si on se place sur le versant de la conscience, il suffit de citer la célèbre maxime de François Rabelais : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Ceci signifie que les scientifiques doivent collecter sans préjugés et sans conflits d’intérêt les preuves et les contre-preuves.
Si on se place du côté de la prudence, les médias « grand public » devraient balayer devant leur porte afin de ne pas stigmatiser un médicament avant que toute la lumière ne soit faite. Ceci éviterait de prendre à contre-pied les experts et les médecins prescripteurs, qui apprennent par la presse « grand public » des informations qui devraient leur être communiquées en priorité par les scientifiques, les agences officielles et les experts.
La prescription médicale y gagnerait sûrement en sérénité, mais il est probable que ces propositions resteront un vœu pieu, car la multiplication des moyens de communication et d’information ne fera peut-être qu’aggraver la confusion pour déstabiliser des patients qui se posent des questions sur l’innocuité de leur traitement.
L’auteur déclare avoir été membre des Commissions de recommandations américaines (Consensus Conference Recommendations of the American Association of Clinical Endocrinologists, janvier 2005, Washington DC) et internationales (IDF Guidelines for Management of post meal glucose in Diabetes éditées en 2007 puis révisées en 2011).
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :