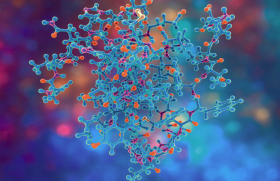Publié le 30 avr 2025Lecture 11 min
Les insulines hebdomadaires dans le traitement des diabètes : l’an I est-il pour demain ?
Louis MONNIER, Claude COLETTE, Université de Montpellier

Le traitement des personnes diabétiques devrait assurer un contrôle de l’homéostasie glycémique aussi proche que possible de la normale en réduisant l’exposition chronique au glucose, les fluctuations glycémiques intra et inter-journalières et les risques d’hypoglycémie. De plus, ces objectifs devraient être atteints en minimisant les contraintes au niveau individuel et en permettant un accès aux traitements hypoglycémiants à un coût raisonnable au niveau collectif.
Il convient malheureusement de reconnaître qu’à travers le monde de nombreux patients diabétiques insulino-dépendants ou requérants ne bénéficient pas de traitements insuliniques correspondant à leurs besoins. Les barrières sont financières, quand les traitements ne sont pas pris en charge par des organismes d’assurance maladie, mais elles sont également éducatives ou technologiques avec les traitements insuliniques sophistiqués, tels que les systèmes automatisés de délivrance de l’insuline. Dans ces conditions, il convient d’analyser à la lumière des dernières publications(1), les promesses offertes par les insulines hebdomadaires au cours des années à venir dans les traitements des diabètes de type 1 et des diabètes de type 2 quand ces derniers deviennent insulino-requérants. Plus précisément, les insulines hebdomadaires pourraient se substituer aux insulines basales traditionnelles (dégludec et glargine) qui imposent une injection quotidienne(1-3).
Les deux procédés pour obtenir des insulines à durée d’action hebdomadaire(1,2)
Une première piste a été empruntée par le laboratoire Novo Nordisk avec le développement de l’insuline icodec. Pour concevoir cette insuline, deux modifications ont été utilisées. Tout d’abord, à l’instar de la dégludec (analogue lent de l’insuline dont la durée d’action dépasse les 24 heures, mais qui nécessite une injection quotidienne pour couvrir des besoins insuliniques de base) l’icodec fait partie du groupe des insulines acylées, avec l’insertion d’un acide gras en C20 sur l’acide aminé en position B29 (résidu lysine) de l’insuline. L’insertion de cet acide gras est réalisée grâce à un « spacer » constitué par un oligoéthylène glycol de l’acide gamma glutamique (figure 1). Cette modification permet à l’icodec de se protracter dans le tissu cellulaire sous-cutané après injection, puis de se fixer sur l’albumine plasmatique au fur et à mesure de sa libération progressive à partir de sa configuration « protractée » telle qu’elle existe dans le tissu cellulaire sous-cutané. Pour prolonger encore plus sa durée d’action, 3 acides aminés ont été l’objet de substitutions en position A14, B16 et B25 (figure 1). La modification la plus importante est celle qui porte sur la position B25 où la phénylalanine a été remplacée par de l’histidine (figure 1). Dans la mesure où la zone comprise entre les acides aminés B23 et B26 joue un rôle fondamental dans la liaison de l’insuline à son récepteur, cette substitution permet de ralentir la fixation de l’insuline sur son récepteur. Par voie de conséquence, elle prolonge son action. La demivie de l’icodec a été évaluée à 8,2 jours à partir des études de pharmacocinétique.
Figure 1. Structure de l’insuline icodec. Les chaînes A et B de l’insuline sont respectivement représentées en bleu et en rouge.
La deuxième piste a été empruntée par le laboratoire Eli Lilly avec l’insuline BIF (« Basal Insulin Fc ») développée sous le terme d’insuline « Efsitora ». Il s’agit d’une formulation constituée par un homodimère d’analogues des chaînes A et B de l’insuline, lequel est fusionné de manière covalente à la fraction cristallisable d’une immunoglobuline IgG2 (figure 2). Cette manipulation confère à cette insuline modifiée une demi-vie de 17 jours par alignement sur celle de l’immunoglobuline.
Figure 2. Structure de l’insuline Efsitora.
Que nous apprennent les études contrôlées et randomisées de phase II ?
Pour l’icodec, l’efficacité jugée sur l’HbA1c a été comparable à celle obtenue avec la glargine U100 prise comme comparateur. La tendance à observer des hypoglycémies plus fréquentes qu’avec la glargine U100 dans certaines études réalisées dans le diabète de type 2(4) a été corrigée lorsque la titration de l’icodec a été faite en se basant sur le maintien d’une glycémie avant le petit déjeuner entre 4,4 et 7,2 mmol/l (0,80 et 1,30 g/l) au lieu de 3,9-6,0 mmol/l (0,70- 1,10 g/l)(5). Ceci souligne que la titration au moment de l’initiation des insulines hebdomadaires et leur adaptation au cours des traitements doit se faire à doses progressives en raison du phénomène d’empilement (« stacking ») des doses qui pose un problème chaque fois que les insulines ont une durée d’action qui s’étend au-delà du moment de l’injection de la prochaine dose(6,7).
Pour la BIF (Efsitora), le comparateur utilisé a été la dégludec (2 études dans le diabète de type 2 et une dans le diabète de type 1)(1). Dans les deux types de diabète, les résultats sur l’HbA1c ont été comparables avec la BIF et la dégludec. Les résultats sur le risque hypoglycémique ont été contrastés : risque un peu plus élevé avec le BIF dans certaines études, ou plus faible dans d’autres, le tout conduisant à une absence de différence significative quand les résultats sont analysés de manière globale.
Que nous apprennent les études contrôlées et randomisées de phase III ?
Pour l’icodec
Les études ONWARDS (1 à 5) ont comparé dans le diabète de type 2 l’efficacité et la sécurité de l’insuline icodec par rapport aux analogues lents traditionnels de l’insuline (glargine U100, glargine U300 et dégludec)(1). L’étude ONWARDS 1 a été réalisée chez des patients ayant un diabète de type 2, « naïfs » de toute insulinothérapie, avec pour comparateur la glargine U100. L’étude ONWARDS 2 a été menée chez des patients ayant un diabète de type 2, déjà traités par insuline, avec pour comparateur la dégludec. Les études ONWARDS 3 et 5 sont des essais comparatifs entre l’icodec et la dégludec (ONWARDS 3) et entre l’icodec et la glargine U100 ou U300 (ONWARDS 5) chez des sujets diabétiques de type 2 exempts de toute insulinothérapie avant l’entrée dans l’essai. Dans l’étude ONDWARDS 4, la comparaison icodec versus glargine U100 a été effectuée chez des patients ayant un diabète de type 2 déjà traité par insuline, mais nécessitant un schéma basal-bolus sous forme de multi-injections quotidiennes d’insuline. Enfin, l’étude ONWARDS 6 est la seule dans le cadre de ces études qui a été réalisée chez des diabétiques de type 1 traités par des schémas basal-bolus : icodec versus dégludec.
En ce qui concerne l’HbA1c, toutes les études ONWARDS de phase III ont confirmé les résultats observés dans les phases II, à savoir une efficacité comparable entre l’icodec et ses comparateurs (figure 3). Il en est de même pour les résultats en termes de sécurité (hypoglycémies de niveaux 2 et 3) pour les patients ayant un diabète de type 2 (études ONDWARDS 1 à 5) (figure 3). Il convient de noter (résultat non représenté sur la figure 3) que l’incidence des hypoglycémies sévères (nombre d’événements par participant pour une année d’exposition, EPA) a été légèrement, mais significativement (p = 0,01) plus élevée dans le groupe icodec (0,32) que dans le groupe dégludec (0,12). Quand L’icodec est comparée à l’insuline dégludec chez les patients ayant un diabète de type 1 (étude ONWARDS 6), le risque d’hypoglycémie est franchement plus élevé (p < 0,001) sous icodec (19,93 EPA) que sous dégludec (10,73 EPA) (figure 3).
Figure 3. Principaux résultats des études de phase III avec les insulines hebdomadaires icodec (études ONWARDS) et Efsitora (études QWINT) ; les comparateurs sont des analogues lents classiques (dégludec, glargine U100 ou U300). Les études ONWARDS 1 à 5 et QWINT-2 ont été réalisées chez des diabétiques de type 2. Les études ONWARDS 6 et QWINT-5 ont été réalisées chez des diabétiques de type 1.
Pour la BIF (Efsitora)
Plusieurs études interventionnelles ont été programmées sous l’acronyme QWINT (Once Weekly [QW] Insulin Therapy)(8), Ces études multicentriques, contrôlées et randomisées au nombre de 5, ont comparé l’Efsitora à une insuline lente basale traditionnelle.
Dans l’étude QWINT-1 les patients inclus sont des diabétiques de type 2 « naïfs » de tout traitement insulinique, le but étant essentiellement d’étudier la titration initiale et progressive de l’insuline Efsitora. Pour cela, la première dose d’Efsitora a été administrée sur la base de 100 unités avec ultérieurement une augmentation progressive par paliers et par tranches de 4 semaines, sans dépasser une dose maximale de 400 unités par semaine. La décision d’augmentation de dose était prise quand la glycémie à jeun restait supérieure à 1,30 g/l et à condition que le sujet n’ait pas eu d’hypoglycémie.
L’étude QWINT-2 a été conduite dans la même population de sujets (diabétiques de type 2) que dans QWINT-1 afin d’étudier la non-infériorité de l’Efsitora par rapport à son comparateur, l’insuline dégludec(9). La comparaison a montré une efficacité identique sur l’HbA1c (-1,26 % en pourcentage de point pour l’Efsitora versus -1,17 % pour la dégludec) (figure 3). La sécurité jugée sur les hypoglycémies a été identique : 0,58 EPA avec l’Efsitora versus 0,45 avec la dé gludec (figure 3). Au terme des 52 semaines de l’étude, les doses d’insuline (unités/semaine) ont été identiques avec l’Efsitora (314,7 unités) et avec la dégludec (334,4 unités). Cette étude a donc permis de préciser la titration de l’Efsitora et de montrer qu’elle est superposable à celle de la dégludec prise comme référence.
Les études QWINT-3 et -4 ont été menées chez des patients ayant un diabète de type 2, traités au préalable par de l’insuline(8). Les résultats n’ont pas été encore publiés. Ces études ont surtout été destinées à étudier la titration de l’Efsitora en comparaison avec la dégludec (QWINT-3) ou avec la glargine U100 (QWINT-4) avec pour objectif d’obtenir des glycémies à jeun comprises entre 0,80 et 1,20 g/L dans cette catégorie de patients.
Les résultats de l’étude QWINT-5 ont été publiés récemment(10). Dans cette étude réalisée de manière spécifique dans le diabète de type 1, l’Efsitora a été comparée à la dégludec dans le cadre d’un traitement insulinique de type basal-bolus, les bolus préprandiaux étant assurés avec de l’insuline Lispro. Les résultats (figure 3) ont montré que l’Efsitora hebdomadaire et la dégludec quotidienne quand elles sont utilisées pour couvrir les besoins insuliniques de base chez des diabétiques de type 1 conduisent au même résultat en termes d’efficacité sur l’HbA1c à la 26e semaine : -0,51 % (pourcentage de point) avec l’Efsitora et -0,56 % avec la dégludec. Les doses d’insuline basale (unités/semaine) à la 26e et à la 52e semaine de l’étude n’ont pas été différentes avec l’Efsitora (199,5 unités/semaine à la 26e semaine et 204,4 à la 52e semaine) et avec la dégludec (208,5 unités/semaine à la 26e semaine et 211,3 à la 52e semaine). En revanche, les hypoglycémies de niveau 2 et 3 ont été plus fréquentes avec l’Efsitora (14,03 EPA) qu’avec la dégludec (11,59 EPA) (figure 3).
En conclusion cette étude a montré que, dans le diabète de type 1, pour une réduction comparable de l’exposition chronique au glucose (HbA1c) l’Efsitora conduit à une incidence plus élevée des hypoglycémies.
Quelles conclusions générales peut-on tirer des études sur les insulines hebdomadaires ?
Pour résumer les résultats observés dans les différentes études (ONWARDS pour l’icodec et QWINT pour l’Efsitora), il apparaît que les insulines hebdomadaires ont globalement la même efficacité que les insulines basales classiques (dégludec ou glargine) sur l’exposition chronique au glucose (« hyperglycémie ambiante ») et qu’elles ne conduisent pas à une « surexpression » des hypoglycémies dans le diabète de type 2. En revanche, dans le diabète de type 1 l’incidence des hypoglycémies augmente sous insulines hebdomadaires. À la lumière de ces observations, la question est de savoir quels patients pourraient bénéficier des insulines hebdomadaires.
Pour le diabète de type 2, les insulines hebdomadaires semblent représenter une alternative crédible aux insulines basales classiques, c’est-à-dire aux analogues lents qui nécessitent une injection quotidienne en raison de leur durée d’action (24 heures ou légèrement supérieure). En d’autres termes, leurs indications se situent dans le même créneau de prescription que celui des insulines lentes traditionnelles chez les personnes ayant un diabète de type 2 qui échappe aux traitements hypoglycémiants non insuliniques : metformine en association à des inhibiteurs du SGLT2/agonistes du récepteur du GLP-1 à doses maximales tolérées. Elles apparaissent donc comme des « traitements de 3e ligne ». Compte tenu du risque d’hypoglycémie légèrement plus élevé avec les insulines hebdomadaires, il sera conseillé d’une part d’interrompre les traitements par insulinosécrétagogues non glucodépendants (glinides, sulfonylurées) qui sont susceptibles de faciliter la survenue des hypoglycémies et d’autre part de fixer l’objectif de glycémie à jeun (avant le petit déjeuner) aux alentours de 7,2 mmol/l (1,3 g/l). Cet objectif est un peu moins ambitieux que celui qui avait été fixé dans la plupart des études de phase II(1). Ainsi l’impression générale est, dans l’ensemble, positive quand on sait que ces insulines faciliteront probablement le traitement du diabète sucré de type 2.
Pour le diabète de type 1, les études ONWARDS 6 et QWINT5 ont montré que les insulines hebdomadaires augmentent le risque d’hypoglycémies quand elles sont utilisées comme insulines basales dans le cadre d’un schéma insulinique basal-bolus par multi-injections. Ceci n’a rien de surprenant, car il est bien connu que les diabètes de type 1 sont beaucoup plus instables que les diabètes de type 2 avec une incidence beaucoup plus élevée des hypoglycémies, comme l’indique d’ailleurs la figure 3. Pour combattre cette instabilité glycémique intra et inter-journalière qui caractérise les diabètes de type 1 et qui est, par elle-même, source d’hypoglycémies(11,12), il est indispensable d’ajuster les doses d’insuline dans des délais relativement courts. Ceci semble a priori incompatible avec l’administration d’insulines hebdomadaires dont les doses sont figées et non modulables sur une période de 7 jours une fois qu’elles ont été injectées. Pour cette raison, il est probable que les insulines hebdomadaires seront difficilement utilisables dans le diabète de type 1, surtout à une époque où l’avenir réside dans l’utilisation de systèmes automatisés de délivrance de l’insuline avec des technologies de plus en plus sophistiquées permettant d’ajuster les doses d’insuline aux besoins instantanés(13).
In fine et pour revenir au titre de cet article « Les insulines hebdomadaires dans le traitement des diabètes : l’an I est-il pour demain ? », on semble s’acheminer vers la réponse suivante : probablement OUI dans le diabète de type 2 ; probablement NON dans le diabète de type 1 sauf cas particulier.
Pour le diabète de type 1, il est suggéré(1,3) que des études supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires. À cet égard, qu’il nous soit permis de faire deux suggestions : a) celle de comparer les traitements par insulines hebdomadaires en mode basal-bolus avec l’utilisation d’une délivrance automatisée de l’insuline en boucle fermée ; et b) celle d’intégrer dans les études l’un des grands facteurs responsables des hypoglycémies : la variabilité glycémique (absente à ce jour dans les études publiées)(11,12).
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :